 Lucian Blaga, În marea trecere / Dans le grand passage, édition bilingue. Traduction du roumain et avant-propos par Jean Poncet, postface par Horia Bădescu. Jacques André éditeur / Editura Şcoala Ardeleană, 2018
Lucian Blaga, În marea trecere / Dans le grand passage, édition bilingue. Traduction du roumain et avant-propos par Jean Poncet, postface par Horia Bădescu. Jacques André éditeur / Editura Şcoala Ardeleană, 2018
L’éditeur lyonnais Jacques André tient ses promesses : le troisième recueil de Lucian Blaga, În marea trecere / Dans le grand passage, traduit comme les précédents par Jean Poncet, vient de paraître. Et voilà le chroniqueur comblé, parce qu’il s’aperçoit qu’il a maintenant sur les rayons de sa bibliothèque trois versions bilingues de ce recueil, initialement paru en 1924 : la première, comprise dans un vaste volume intitulé Poemele luminii /Les poèmes de la lumière et traduit par Paul Miclău pour les éditions Minerva (Bucarest), date de 1978 ; la seconde, intitulée În marea trecere / Au fil du grand parcours, est parue en 2003 aux éditions Paralela 45 (Piteşti) dans une traduction de Philippe Loubière ; et la troisième est celle dont il est ici question. Tout cela pour mettre l’accent sur le succès de Lucian Blaga auprès des traducteurs, des éditeurs et des lecteurs, qui peuvent ainsi disposer de trois traductions du recueil. Chaque traduction de valeur (ce qui est le cas) non seulement contribue à mieux faire connaître l’œuvre, mais l’enrichit de résonances nouvelles.
Mon intention n’est pas de les comparer, ces traductions (ni évidemment de les hiérarchiser). On aura vu les variations du titre (Philippe Loubière). Un simple aperçu des trois premiers vers du premier poème (« Către cititori », « Aux lecteurs ») suffira à mesurer combien la traduction de la poésie, d’une manière générale, est affaire non seulement de compétence linguistique, mais aussi de sensibilité personnelle.
Paul Miclău : C’est ici ma maison. Là le soleil, le jardin et ses ruches.
Vous passez sur la route, regardez par la grille de la porte
et attendez que je parle. – Mais par où commencer ?
Philippe Loubière : Ma maison est ici. Derrière
Est le soleil et le jardin avec ses ruches.
Vous qui passez sur le chemin,
Vous voyez à travers les barreaux du portail
Et guettez mes propos. Par où commencerais-je ?
Jean Poncet : Ici est ma maison. Là le soleil et le jardin avec ses ruches.
Vous qui passez sur la route, vous regardez par la grille du portail,
Attendant que je parle. – Par où commencer ?
À chacun de se faire son idée.
Par où poursuivre ? Par le volume qui nous occupe principalement dans cette chronique. Dans son avant-propos, Jean Poncet insiste sur le sens du titre et sur la substance du recueil, que ce titre synthétise : le « grand passage » est celui qui mène vers la mort, et dans sa postface, Horia Bădescu évoque ce qui est pour lui le thème central : « la tentation du silence et la sémantique de l’absence ». Face au monde, se taire et disparaître. Poncet et Bădescu, tous deux poètes, perçoivent profondément ce qui est au cœur des vers de Blaga : le pessimisme, qui transforme les prières en mots « amers », l’espérance en aspiration vers le vide. Mais ce pessimisme n’est pas absolu. Si les textes sacrés sont revisités, c’est au profit d’images nouvelles, d’une osmose entre le « je » et la nature :
Seul mon sang brame dans les bois
à son enfance lointaine
tel un cerf fatigué
à sa biche perdue dans la mort.
Et « le mot se fait acte », chantant et bâtissant toujours le village cher au poète (« En vérité l’éternité est née dans le village ») et redisant le goût de la vie simple, dans une présence au monde qui met la contemplation et l’art au-dessus de l’action (« Je danse au-dessus de l’action »).
Les recueils de Lucian Blaga se suivent sans se ressembler, dans une évolution qui frise la contradiction. Mais une contradiction qui se résout dans une perspective constructive : le cheminement vers la mort, le désir de silence et d’invisibilité ne peuvent passer que par un « être au monde » lyrique et créateur.
Jean-Pierre Longre
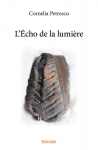 Cornelia Petrescu, L’Écho de la lumière, Edilivre, 2018
Cornelia Petrescu, L’Écho de la lumière, Edilivre, 2018 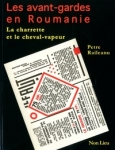 Petre Raileanu, Les avant-gardes en Roumanie, La charrette et le cheval-vapeur, éditions Non Lieu, 2018
Petre Raileanu, Les avant-gardes en Roumanie, La charrette et le cheval-vapeur, éditions Non Lieu, 2018 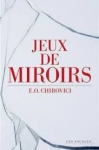 E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018
E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018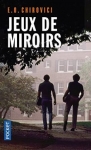 On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».
On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».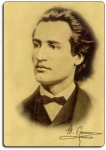

 Parmi les grands, figure en bonne place le Prix Nobel de Littérature 2009,
Parmi les grands, figure en bonne place le Prix Nobel de Littérature 2009, 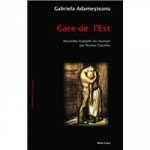 Gabriela Adameşteanu, Gare de l’Est. Nouvelles traduites du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2018.
Gabriela Adameşteanu, Gare de l’Est. Nouvelles traduites du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2018. Benjamin Fondane, Devant l’Histoire, textes réunis et présentés par Monique Jutrin, éditions de l’éclat, 2018
Benjamin Fondane, Devant l’Histoire, textes réunis et présentés par Monique Jutrin, éditions de l’éclat, 2018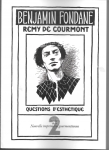 Parution à signaler
Parution à signaler George Vulturescu, Les Pierres du Nord, recueil bilingue, traduit du roumain par Jean Poncet, e
George Vulturescu, Les Pierres du Nord, recueil bilingue, traduit du roumain par Jean Poncet, e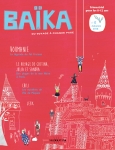 Revue Baïka n° 12, éditions Salmantina, automne 2018
Revue Baïka n° 12, éditions Salmantina, automne 2018
 Laurent Geslin, Jean-Arnault Dérens, Là où se mêlent les eaux, « Des Balkans au Caucase, dans l’Europe des confins », La Découverte, 2018
Laurent Geslin, Jean-Arnault Dérens, Là où se mêlent les eaux, « Des Balkans au Caucase, dans l’Europe des confins », La Découverte, 2018  Vasile George Dâncu, Maman Univers / Universul Mama, traduit du roumain par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2018
Vasile George Dâncu, Maman Univers / Universul Mama, traduit du roumain par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2018  Jacques Baujard, Simon Géliot, Codine, d’après la nouvelle de Panaït Istrati, La boîte à bulles, 2018
Jacques Baujard, Simon Géliot, Codine, d’après la nouvelle de Panaït Istrati, La boîte à bulles, 2018  Marin Mincu, Journal de Dracula, traduction du roumain, avant-propos et notes de Dominique Ilea, Xenia, 2018
Marin Mincu, Journal de Dracula, traduction du roumain, avant-propos et notes de Dominique Ilea, Xenia, 2018 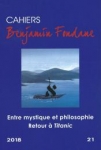 Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane